- Aug 16, 2025
Arbre généalogique & syndrome du gisant : méthode pas à pas
- 💕Peggy & Mathieu de J'ose et Alors
- 0 comments
Et si la clef de votre mal-être se cachait dans les racines de votre arbre familial ?
Loin d’être un simple outil pour retrouver ses origines, l’arbre généalogique devient, en psychogénéalogie, un miroir des transmissions invisibles, des deuils non faits, des loyautés inconscientes… et parfois du syndrome du gisant.
Certaines dates se répètent, certains prénoms reviennent comme des échos, certaines branches restent mystérieusement vides… Autant d’indices que l’inconscient familial a laissé sa trace, parfois en silence, dans votre propre vie.
Dans cet article, je vous guide à travers une méthode simple et intuitive pour décrypter votre arbre généalogique avec un regard transgénérationnel. Objectif : repérer les signes possibles d’un gisant, comprendre les dynamiques à l’œuvre, et amorcer un chemin de libération intérieure.
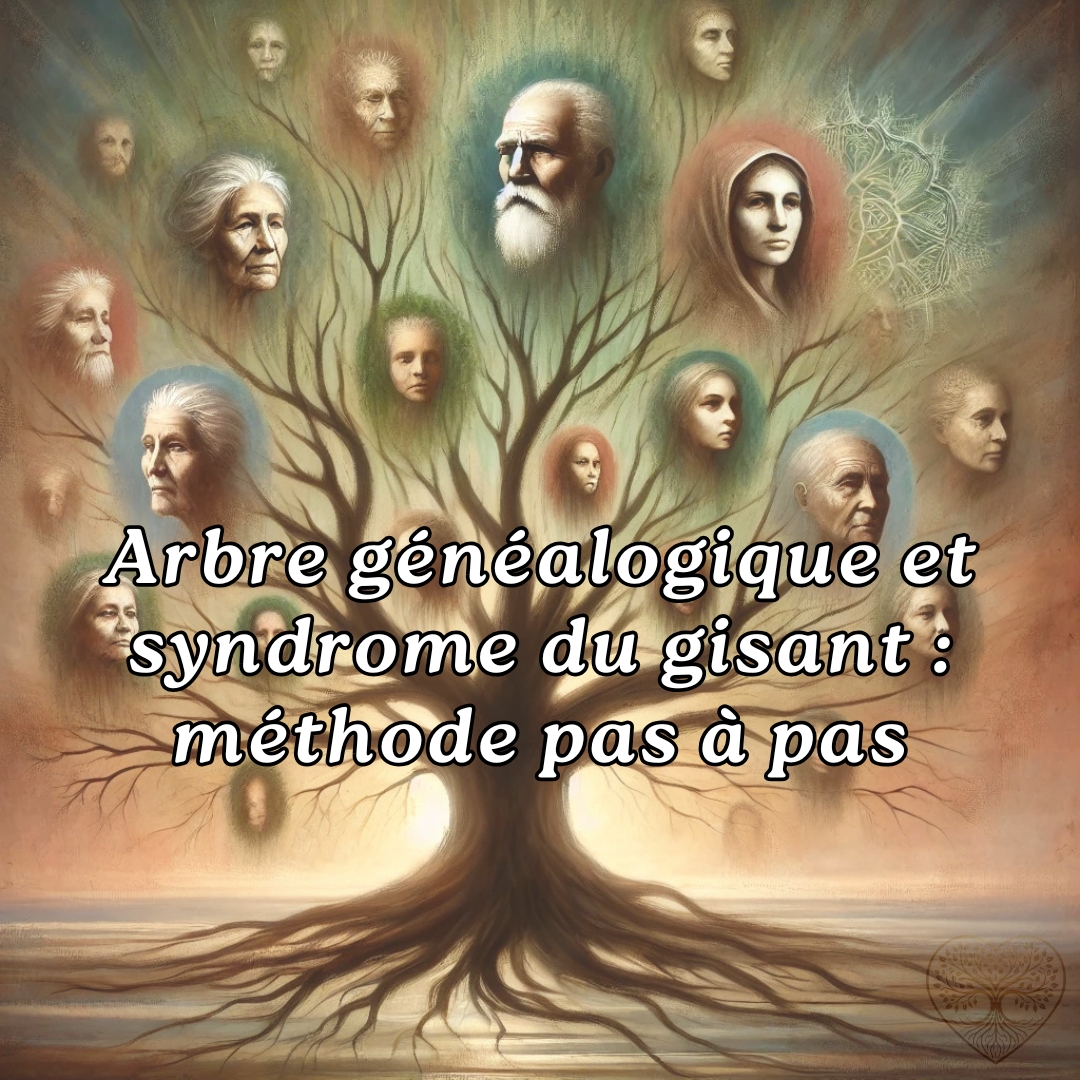
Pourquoi explorer son arbre généalogique ?
Un outil symbolique de révélation
Construire son arbre généalogique, ce n’est pas seulement poser des noms et des dates. C’est rendre visible l’invisible. Chaque case vide, chaque prénom répété, chaque silence familial devient une porte d’entrée vers une mémoire enfouie.
En psychogénéalogie, l’arbre devient un espace de vérité intérieure : il permet d’identifier des répétitions de destins, des blocages transmis de génération en génération, et des loyautés invisibles qui pèsent parfois sur notre capacité à vivre pleinement notre propre vie.
Le syndrome du gisant dans l’arbre
Le syndrome du gisant, qu’il soit horizontal ou vertical, trouve souvent ses racines dans des zones de l’arbre où la mort, l’oubli ou le non-dit ont laissé une empreinte profonde. Ces empreintes ne disparaissent pas avec le temps : elles se transmettent si elles ne sont pas vues, nommées, reconnues.
En explorant votre arbre, vous pouvez commencer à comprendre pour qui vous portez, quelle mémoire vous rejouez, ou à quelle blessure familiale votre histoire est liée.
Les éléments clés à observer dans l’arbre
Les prénoms répétés ou proches
Les prénoms portés dans une famille sont rarement anodins. Lorsqu’un enfant reçoit le prénom d’un ancêtre décédé tragiquement, d’un frère ou d’une sœur disparu, ou d’un membre “effacé” de l’histoire familiale, cela peut créer une identification inconsciente puissante.
Exemple : une femme prénommée Jeanne comme une tante morte à 3 ans, et dont personne ne parle jamais. Sans le savoir, cette femme peut être prise dans une dynamique de “remplacement symbolique”, vivant à la place d’une autre, ou pour réparer son absence.
Même une variation de prénom (Jean / Jeanne / Jeannot) peut suffire à activer cette mémoire silencieuse. C’est l’intention familiale inconsciente, pas la forme exacte du prénom, qui agit.
Les dates qui se répondent
Une autre piste précieuse : les dates. Regardez si des naissances surviennent proche de dates de décès, ou si certaines périodes de l’année concentrent des événements marquants (deuils, séparations, maladies…).
Exemple : une naissance le 3 juin alors qu’un oncle est mort le 4 juin, ou une série de décès début novembre, à chaque génération. Ces coïncidences temporelles sont souvent des signaux de répétitions transgénérationnelles — parfois inconscientes, mais très actives.
C’est particulièrement vrai dans les cas d’enfant de remplacement, où la venue au monde vise à “réparer” une perte.
Les silences, les blancs, les branches oubliées
Les absents parlent parfois plus fort que les présents. Une case vide dans l’arbre, une personne dont on ne connaît ni le prénom ni la cause de décès, une branche familiale “dont on ne parle pas”… tout cela peut révéler un traumatisme, une exclusion, un non-dit.
Le gisant trouve souvent sa place dans ces trous de mémoire collective, là où la parole s’est tue.

Comment construire et analyser son arbre pas à pas
Étape 1 – Rassembler les informations disponibles
Commencez simplement. Notez ce que vous connaissez : vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents si possible. Ne vous inquiétez pas des “trous” : ils sont parlants. L’important est de créer un espace de visualisation où les données peuvent émerger.
Pour chaque personne, notez :
le prénom (officiel et surnoms éventuels)
les dates de naissance et de décès
les événements marquants (exils, pertes, maladies, accidents)
les relations : mariages, séparations, abandons
Un simple tableau ou une feuille de papier suffit. L’important, c’est l’intention de regard que vous y posez.
Étape 2 – Repérer les motifs et anomalies
Une fois les données rassemblées, prenez du recul et observez :
des prénoms qui reviennent ?
des dates qui se répondent ?
des silences sur certaines personnes ?
des morts jeunes ou tragiques oubliées ?
Vous pouvez aussi utiliser des couleurs ou des symboles pour marquer :
les décès avant 20 ans
les zones de flou
les lignées avec beaucoup de pertes ou de répétitions
C’est là que la logique transgénérationnelle commence à apparaître. Vous commencez à voir les loyautés invisibles.
Étape 3 – Observer vos ressentis pendant l’exploration
L’analyse ne se fait pas qu’avec la tête. Faites des pauses et ressentez. Certains prénoms vous attirent ? D’autres vous dérangent ? Des frissons, une tristesse soudaine, une fatigue étrange ?
Ce sont des signes que votre corps entre en résonance avec une mémoire familiale vivante. Prenez des notes. N’essayez pas de tout expliquer. L’intuition est votre meilleure alliée dans ce processus.

Exemple pratique d’identification d’un gisant dans un arbre
Prenons le cas de Claire, 42 ans, qui consulte pour un sentiment diffus de ne pas exister pleinement, une mélancolie persistante et une difficulté à construire sa vie professionnelle. En thérapie, elle évoque un sentiment d’invisibilité, d’être “là sans y être vraiment”.
À la demande de sa thérapeute, elle commence à reconstituer son arbre généalogique. Elle découvre que :
elle est née un 17 octobre
son oncle paternel est mort à 20 ans… le 18 octobre, 10 ans avant sa naissance
elle porte le même deuxième prénom que cet oncle disparu
il n’est jamais évoqué en famille ; sa photo n’existe nulle part
Claire réalise qu’elle pourrait porter inconsciemment la mémoire de cet oncle, et vivre à sa place, dans le silence. L’émotion monte. Le lien est là, vivant.
En poursuivant l’exploration, elle observe aussi que plusieurs femmes de sa lignée maternelle ont abandonné des projets créatifs à cause de responsabilités familiales. Elle se sent soudain prise entre deux loyautés : réparer une perte côté paternel, et répéter un schéma d’effacement côté maternel.
Ce type de prise de conscience ne “règle” pas tout en un instant. Mais il amorce un travail de libération puissant. Claire décide alors de rendre symboliquement sa place à son oncle, et d’assumer enfin la sienne.
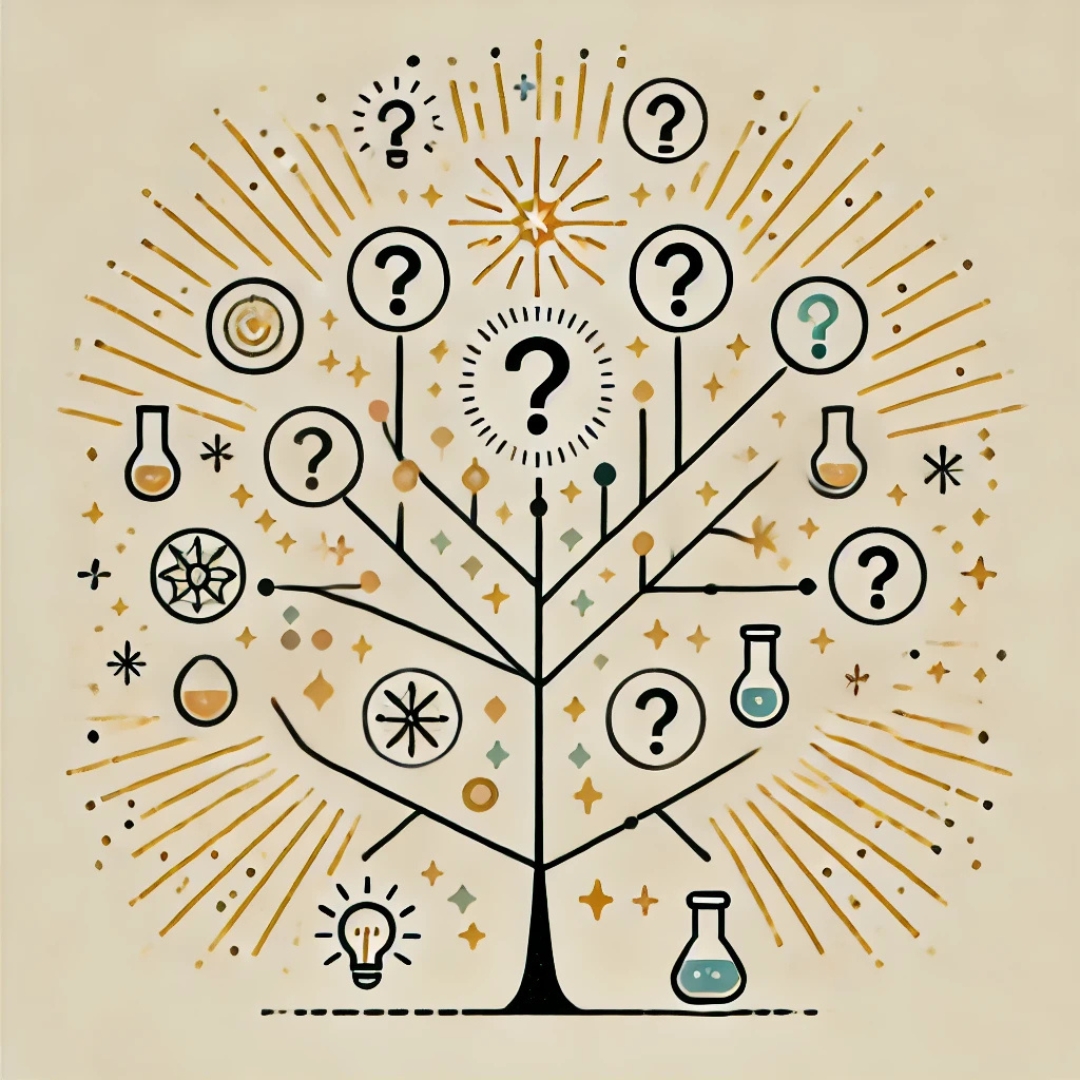
FAQ – Questions fréquentes sur l’arbre transgénérationnel
Faut-il absolument connaître toutes les dates pour faire son arbre ?
Non. Ce qui compte, c’est de commencer avec ce que vous avez. Les “trous” sont souvent aussi révélateurs que les informations complètes. Le flou, le silence, l’absence… sont des pistes en eux-mêmes.
Je ne connais presque rien de ma lignée, est-ce que je peux quand même travailler sur le syndrome du gisant ?
Oui. Votre ressenti, vos symptômes, vos intuitions sont aussi des portes d’entrée. Le travail transgénérationnel n’est pas une enquête policière, c’est un processus de reconnaissance intérieure. Vous pouvez avancer même sans dossier familial complet.
Faut-il être accompagné pour faire ce travail ?
Ce n’est pas une obligation, mais c’est souvent précieux. Un regard extérieur, formé à la psychogénéalogie ou au transgénérationnel, peut vous aider à décoder des liens que vous ne voyez pas encore. Et surtout, à libérer ce qui est resté bloqué.
Pour aller plus loin :